L’année dernière je vous faisais le bilan de ce qui était ma première année comme responsable d’un département de formation dans un IUT. Le meilleur département infocom du meilleur IUT de la galaxie connue, soit dit en passant. C’est une responsabilité que je continue d’occuper avec une forme de plaisir mais je sais à quel point ce plaisir est conditionné à l’équipe de collègues qui le rend possible, et à ma propre capacité à regarder cet exercice de responsabilité avec la distance nécessaire pour en partager publiquement les limites, les frustrations, et les enthousiasmes aussi.
En plus d’être donc responsable de ce département, je suis également depuis cette année directeur adjoint de l’IUT (en charge de la formation). L’administration universitaire ayant pour les acronymes la même passion qu’un cruciverbiste pour les mots de 2 lettres n’existant qu’à l’horizon linguistique qu’il partage avec sa famille, je me suis donc auto attribué le titre de DAFS : Directeur Adjoint Formation Stagiaire. Stagiaire parce que je considère qu’en cette fonction comme en d’autres, la première année ne saurait être autre chose qu’une sorte de grand stage de découverte 🙂

« sans déconner c’est toi le nouveau DAFS ? »
Premier constat, nous sommes le 19 Juillet, et je ne pars en vacances qu’aujourd’hui. Pour revenir à l’IUT dans 4 semaines. C’est à dire ce qui est le lot d’une immensité de fonctionnaires et de collègues, mais, pour ce qui concerne l’université, principalement de collègues BIATSS (agents techniques et administratifs).
Je ne vais bien sûr pas pouvoir vous parler avec autant de transparence que je le fais d’habitude de l’année que j’ai passée, puisque le faire impliquerait de mettre nécessairement des collègues, des services ou des instances dans des situations … complexes. Mais je vais tout de même tenter de vous partager quelques points essentiels de ce que j’ai observé (et parfois appris).
Une rentrée et l’impression déjà, de ne pas s’en sortir.
La rentrée universitaire à l’échelle de l’université de Nantes fut traversée d’une série de soubresauts inquiétants, et dont la répétition et l’ampleur, à chaque nouvelle rentrée universitaire, et à Nantes comme ailleurs, doit nous amener à ne rien céder sur le combat que nous menons face à des politiques ministérielles qui ont l’assèchement de l’université publique comme fonction et son effondrement comme horizon. En témoigne encore l’un des derniers gestes politiques de l’actuelle ministre Sylvie Retailleau qui profite de ses (j’espère en tout cas) derniers instants pour permettre aux écoles privées de taper dans le fonds de la CVEC (contribution à la vie étudiante) à la même hauteur que les universités publiques (alors que jusqu’ici elles en touchaient moins), universités publiques qui contrairement aux EPMDC (écoles privées moisies délivrant des diplômes en carton) ne pratiquent pas des frais d’inscription ostensiblement discriminatoires.
Bref. Donc malgré l’enthousiasme de ces nouvelles fonctions de DAFS, la rentrée, globalement, démarrait mal. Partout à Nantes comme ailleurs, on apprend que des étudiant.e.s dorment dans leur voiture, faute de logement. Les distributions alimentaires continueront. La misère étudiante sera encore l’angle mort des politiques publiques qui ne l’abordent que sous l’angle de l’aumône conjoncturelle (le repas à un euros mais seulement pour les boursiers parce que faudrait pas que des fils de milliardaires puissent en profiter).
Nous sommes début Octobre, je cause avec une amie dont la fille est en LEA et apprend que sa rentrée, prévue début Septembre a été « décalée ». « Décalée » et « dégradée » aussi. Plein de collègues ont démissionné de leurs « tâches administratives ». Les étudiants n’ont pas d’emploi du temps. Les profs leur donnent rendez-vous dans un couloir et « on verra s’il y a une salle disponible ». Parfois pas de cours pendant deux jours et puis le troisième jour, trois cours en même temps, sur le même créneau, mais sans salle de disponible. Ubu roi. A plein d’endroits de l’université, parfois à la Une de la presse, le plus souvent sans aucune publicité, des services et des composantes explosent littéralement. Et des gens. Tout au long de l’année des tas de démissions, de burn-out, d’arrêts maladie. Dont tellement qui auraient pu être évités si l’Etat, simplement, remplissait son rôle et fournissait aux universités les moyens de fonctionner autrement qu’en gérant de manière structurelle des pénuries.
Début Octobre la libraire Vent d’Ouest, partenaire historique de l’université et de tant de collègues et d’étudiant.e.s, a fermé. Sur sa page Facebook et sur son site elle écrit :
« Chères amies ,chers amis de la Librairie Vent d’Ouest Nous sommes officiellement et définitivement fermé ce jour. Nous vous remercions encore pour tous vos efforts et vos soutiens inconditionnels. Triste journée à avaler malgré une annonce déjà prévue. En espérant que vous ne serez pas happer par les commentaires désobligeants qui ne devraient pas tarder à nous stigmatiser. Si l’université de Nantes fut le déclencheur de notre chute, les nouveaux schémas économiques relatifs aux métiers du livres confondus à l’ambiance politique de ces temps auront détruit la construction sur deux générations d’une diversité éditoriale trop bien éloignée des pauvres monologues tout azimut. Merci à vous tous. »
Sur la vitrine vide de la libraire, à côté de l’affiche indiquant la fermeture définitive, il y a mon texte, imprimé en grand. Seul. Vide. Froid. Triste. Trouble. Ce texte qui n’aura rien changé. Juste un peu expliqué. Essayé en tout cas. Pas un mot, pas une déclaration publique de l’université. Rien. Seul. Vide. Froid. Triste.
Octobre encore. En flânant sur le compte LinkedIn de Nantes Université, je découvre cette page qui m’invite à visiter la boutique de Nantes Université. « Visitez la boutique en ligne d’accessoires éco-conscients » … Heu. C’est quand même compliqué de rester totalement calme et poli.
La bataille des mots.
La vie n’est que cela. En tout cas elle est cet essentiel. A l’université plus qu’ailleurs probablement. Je vais vous raconter une de ces batailles autour d’un de ces mots. Et pourquoi au-delà de cet exemple circonstanciel et qui vous apparaîtra peut-être totalement anecdotique, elle me semble si importante et révélatrice. En plein Conseil d’Administration de Nantes Université (nous devions alors être au mois de Novembre ou Décembre) j’apprends à l’occasion d’un vote sur une augmentation du prélèvement des fonds perçus au titre de l’apprentissage que les formations d’IUT sont mentionnées en tant que « formations payantes. » Stupeur et tremblements (de colère). Nous ? Moi ? En IUT ? Des formations … payantes ??!! Comment des collègues peuvent-ils d’eux-mêmes qualifier des formations universitaires de « formations payantes » ??? Réunion très peu de temps après sur un autre sujet avec un autre aréopage mais je pose le sujet. Aréopage qui finira par reconnaître une « maladresse » et par s’engager à la corriger. J’insiste lourdement (on ne se refait pas …) et forme publiquement le voeu qu’en effet la « maladresse » puisse être corrigée. Fin de la réunion. Violence feutrée des échanges en milieu tempéré. Mais violence quand même. Le surlendemain, dans un autre cadre suite à une autre réunion, des infos circulent selon lesquelles le terme de « formation payante » serait en fait une « stratégie » pour « alerter le ministère« . Personne – à commencer par moi – n’y comprend plus rien mais chacun mesure l’étendue de la confusion (au mieux) ou du foutage de gueule (au pire). Par-delà les tensions, les non-dits, les angles morts habituels de ce genre de cénacles (ça fait quand même un quart de siècle que je traîne mes guêtres dans les couloirs universitaires), ce qui me frappe c’est que tout cela se fait avec l’ivresse courtoise de gens devenus incapables de voir la violence qu’ils imposent aux collectifs qu’ils représentent, incapables de mesurer aussi le fracas qu’ils génèrent, les colères qu’ils ignorent et surtout, surtout, les portes qu’ils ouvrent en grand aux prédations économiques dans lesquelles ils se débattent pourtant et qui finiront par les bouffer tout entiers. Finalement (il aura fallu mon coup de gueule et quelques échanges suivis) les « formations payantes » deviennent des « formations financées« . Je m’en réjouis égoïstement. Une victoire invisible. A bas bruit. Mais qui vaut, je me berce de cette illusion en tout cas, par le rappel au réel qui fut adressé, et par la vigilance constante que nous sommes un certain nombre à opposer à ces « maladresses ».
Fin de l’histoire ? Bah non 🙂 Cinq mois plus tard, un autre cénacle, un autre conseil d’administration ou de pôle, ou de toute autre des ces instances redondantes dont l’université regorge et se gorge et s’engorge ; un diaporama qui circule, et une fois encore, en plein titre de plusieurs diapositives, cette mention de « formations payantes » pour désigner les formations en apprentissage et par alternance. Les murs de mon bureau (et de celui de quelques collègues) vibrent de quelques injures. J’envoie sans attendre un mail à l’ensemble de la liste de diffusion où se trouvent toutes les directions de composantes de l’université de Nantes. Je dois avoir la tronche de Cervantès, cette putain de « formation payante » c’est mon moulin. Nous sommes au lendemain du coup de massue des élections européennes. Je rappelle l’importance de ne rien céder sur les mots car ils installent du réel, et que notre vigilance première est de ne pas salir ou travestir ce qui est notre réel universitaire, c’est à dire – entre autres – le refus total et absolu d’entrer dans des putains de logiques de formations payantes. Ce qui commence par ne pas s’auto-désigner sous ce terme. Personne ne répondra à ce mail. Quinze jours plus tard je serai d’ailleurs dans une autre réunion avec les mêmes personnes que celles à l’origine de cette « maladresse » récurrente … Nous n’en parlerons pas. D’autres sujets. D’autres urgences. D’autres enjeux. D’autres cénacles. Il faut faire bonne figure. Je n’ai d’ailleurs aucune animosité singulière envers les porteurs de ces « maladresses » (ou de ces choix). Je ne convoque pas ici des individualités mais les formes qu’ils occupent et donnent à voir dans le théâtre d’ombre qui régule et rythme la vie universitaire. Je regrette juste d’avoir été incapable de leur faire entendre à quel point ces signes, qui leur semblent à l’évidence si anecdotiques, sont l’essentiel de notre prise sur un réel dont tout est fait par ailleurs pour nous en départir. En plus de 20 ans à l’université j’ai cédé ou reculé sur bien des combats et des revendications, j’ai aussi collé ma démission (administrative) plus d’une fois. Jamais par contre je n’ai souvenir d’avoir cédé sur les mots. Le jour où cela arrivera, soit je serai définitivement devenu un monsieur en costume gris (merci de m’avertir avant par tout moyen à votre convenance y compris le jet de projectiles contondants au visage), soit je serai passé à autre chose et aurai démissionné de toute mission ou fonction impliquant que je représente ou mobilise d’autre gens que moi-même.
Incompétences.
Ce qui m’a le plus frappé durant cette année de DAFS (je ne l’ai bien sûr pas découvert et l’avais déjà observé mais j’en ai eu la confirmation et la documentation constante), c’est l’empilement de décisions et de processus relevant du paradigme de la fausse bonne idée. Des décisions que l’on prend pour ce que l’on croit (parfois sincèrement) être de bonnes raisons, mais qui ne sont motivées au mieux que par des contraintes sur lesquelles on n’a plus aucune prise, et au pire par la haute opinion que l’on a de son expertise supposée en la matière. A la croisée de l’importance des mots et de l’imposture des gens (imposture encore une fois pas singulière ou personnelle mais fonctionnelle et politique), je me souviens de cet épisode totalement lunaire où au lendemain de l’arrivée d’une nouvelle équipe politique élue à la tête de l’université de Nantes, on nous avait proposé de devenir des « préfigurateurs de la vision« , c’est à dire en gros de faire des ateliers post-it pour voir quelles idées on aimerait mettre en oeuvre à l’échelle du nouveau projet de l’université. Je ne sais pas – et je m’en fiche – qui avait eu l’idée d’appeler ça tout à fait sérieusement des « préfigurateurs de la vision » mais je garde de ce moment d’anthologie – et je ne suis pas le seul – l’interrogation et l’angoisse existentielle que génère un système rassemblant des gens aussi intelligents pour les rendre capables de produire, de proposer et d’assumer des trucs aussi cons avec le plus grand sérieux.
Il est deux formes principales d’incompétence dans la gestion d’une université et des collectifs qui la font vivre. La première est l’incompétence qui est la mienne et que je partage avec tant d’autres, et que je qualifierai d’incompétence « fonctionnelle ». Jamais, d’aucune manière et à aucun moment je n’ai quelque compétence que ce soit pour « piloter » ou « administrer » une stratégie faite de matrices excel aux attendus aussi souples et négociables que ceux d’une barre à mine enduite de beurre doux. Ce n’est d’ailleurs pas ce que l’on me demande directement (et heureusement) mais c’est pourtant la situation où l’on se sent souvent attendu. Et il faut avoir attentivement relu Goffman pour ne pas entrer trop vite dans le costume de scène que l’on nous tend. L’université dispose fort heureusement de « services » (finances, scolarité, RH …) qui sont là pour pallier les incompétences qui sont les miennes (et celles de nombreux autres collègues enseignants-chercheurs). Les problèmes commencent lorsque lesdits collègues n’ont pas d’acceptation claire de leur situation d’incompétence et s’inventent des postures de gestionnaire, des carrières de managers, et des avis de ravis de la crèche de l’expertise. Alors bien sûr il en est aussi (et fort heureusement) qui ne mettent que peu de temps à sortir de cette incompétence (ou qui disposent d’une expérience réelle dans l’administration de la chose publique) et qui développent le minimum de savoir-faire (ou d’imposture) qui légitime leur position. Point rassurant (ou pas) : l’incompétence fonctionnelle est la chose la mieux partagée au monde et elle ne se réduit pas aux seuls enseignants-chercheurs désignés pour faire tout autre chose que de l’enseignement et de la recherche et s’y employant parfois avec panache, souvent avec opiniâtreté, et parfois aussi avec une coupable autant que pathétique suffisance … Mais ces empilements d’incompétence par fonction autant que par nature finissent par produire d’inévitables situations de tensions qui, conjuguées avec des paramètres macro-économiques (traduisez : « on ne gère que des pénuries, y’a plus de thune, démerdez-vous avec ça« ), finissent par faire exploser les collectifs et les désirs d’oeuvrer ensemble. L’autre vraie bonne nouvelle c’est que nul n’est totalement et linéairement incompétent (même si certains finissent par développer une sorte d’étrange expertise dans le travestissement de ladite incompétence).
Ce que j’ai aussi découvert et expérimenté cette année, c’est l’interopérabilité fondamentale des incompétences, de l’échelle universitaire (donc locale) à l’échelle ministérielle (donc nationale). A l’occasion de plusieurs dossiers visant à arbitrer des volets RH j’ai vu à quel point il était non seulement possible de faire remonter des données tantôt vérolées et tantôt insincères, et surtout à quel point tout le monde finissait par s’en foutre totalement puisque considérant qu’en effet chacun avait la potentialité de le faire, et que personne n’avait soit le temps, soit l’envie, soit la capacité de prendre le risque de pointer ces tripatouillages au risque d’y perdre l’objet de négociations contractuelles se jouant sur d’autres plans et à d’autres temporalités. A au moins 4 ou 5 reprises cette année j’ai pu observer et documenter à quel point des décisions qui impactent durablement la vie des services et des collectifs sont prises dans un clair-obscur qui écrase toute forme de logique ou de rationalité, y compris même strictement comptable. Bien sûr je m’en doutais. Bien sûr je l’avais déjà observé d’en dessous ou d’en dehors. Mais j’avoue que l’effet produit lorsque l’on est en première ligne est tout à fait sidérant (et assez violent). D’autant qu’il ne s’agit pas d’authentiques malversations délibérées (qui finissent heureusement le plus souvent par être repérées et corrigées) mais je le répète d’une forme d’incompétence douce et partagée, endémique parce que systémique, nourrie et alimentée par les urgences calendaires artificielles ne visant qu’à fabriquer de l’incertitude et de l’intranquilité en permanence, et par les empilements de contraintes qui rendent vain tout effort de faire correctement et proprement les remontées et les travaux attendus. Alors au mieux on improvise, on bricole, on braconne aussi un peu, et on se dit (et l’on a raison) que les autres en font de même. J’ai vu passer cette année des tableaux excel d’une longueur et d’une complexité telle que je défie quiconque d’être en capacité de s’en servir dans une logique décisionnelle rationnelle. C’est cela je crois aussi le climax du néo-management, se débrouiller pour rendre vaine jusqu’à la rationalité d’outils de pilotage que plus personne ne maîtrise en totalité mais sur lesquels chacun s’appuie en partialité. Son combat – celui du néo-management – est définitivement gagné lorsque l’ensemble des espaces de négociation se résument et se tiennent entre les colonnes et les lignes d’un tableau excel. Ce qui est hélas très souvent le cas à l’université.
L’autre incompétence est celle des potentialités. Et elle est de loin, de très loin celle qui l’emporte sur toutes les autres. Celle qui est aussi la plus préoccupante. Au regard des situations de crises structurelles que traversent les universités publiques, au regard aussi du néo-management que l’on tente à toute force d’y mettre en place, au regard des objectifs comptables contraints de performance, d’excellence, de rentabilité et autres queues de comète de la mortifère « économie de la connaissance » qui n’aurait jamais dû prétendre être autre chose qu’une écologie de la connaissance, au regard de l’incapacité globale à faire collectif autrement que par la résignation ou le cloisonnement dans son corps d’origine (les PRAG avec les PRAG, les BIATSS avec les BIATSS, les enseignants-chercheurs avec les enseignants-chercheurs, les McF avec les McF et les PU avec les PU, ad libitum) … au regard de tout cela, l’université et ses personnels ne peuvent pas être, par nature et par destination, autrement et autre chose que non-compétents et non-compétentes.
Nous ne pouvons pas être « compétents » pour assurer un service public de l’enseignement supérieur et de la recherche quand le budget par étudiant dans les universités d’effondre de manière constante.
Nous ne pouvons pas être « compétents » pour assurer et garantir l’excellence de la recherche française quand des milliers de brillantissimes post-doctorants ne trouvent aucun poste à l’université publique et quand l’ensemble des critères paramétriques de la recherche sont alignés sur des modalités d’appels à projets inventés et orchestrés pour refuser l’essentiel desdits projets.
Nous ne pouvons pas être « compétents » pour accompagner nos étudiant.e.s dans leur réussite quand ils et elles crèvent de faim ou de fatigue.
Les agents d’équilibre.
Alors me direz-vous comment tout cela peut-il tenir encore ? Et bien sincèrement et après plus d’un quart de siècle passé à l’université publique, je vous confesse n’en savoir rien. J’ai cependant quelques hypothèses. Dans tous les collectifs que j’ai croisés, dans toutes les fonctions que j’ai occupé (dont celle de DAFS), dans toutes les réunions et projets auxquels j’ai participé, j’ai noté la présence, physique ou en arrière-plan, de ce que j’appelle des agents d’équilibres. Ces agents d’équilibre ce sont (parfois) des enseignants-chercheurs, (très souvent) des personnels administratifs, et (presque) jamais ces gens élus ou nommés qui, tout comme moi, occupent des fonctions « politiques » supposant de préserver ou de maintenir … des équilibres.
Ces agents d’équilibre font en sorte que la machine tourne et que les dysfonctionnements restent aussi incidentels que possible. Ils et elles s’emploient à remplir de potentialité d’existence les décisions pour la plupart imbéciles ou hors-sol que prennent ou proposent la plupart des gens comme moi. Si on fait cet effort minimal de leur prêter une oreille attentive, ils et elles assurent cet essentiel absolu qui consiste à nous ramener au réel et à protéger les gens de chocs trop violents. Sans ces agents d’équilibre qui oeuvrent sans relâche (et le plus souvent sans aucune prime ou reconnaissance non plus), sans ces obscur.e.s sujets de la lutte contre le délire, sans celles et ceux qui sont la seule clarté de l’avenir régalien de l’université publique, voilà déjà longtemps que nous serions toutes et tous tombés. Cet article leur est dédié. Bisous à vous tou.te.s.
Embellie nulle part, embolie partout.
Dans le domaine des ressources humaines (vaste sujet s’il en est …), l’université (celle de Nantes en tout cas) n’a de cesse de recruter différents types de contrats (précaires) sur des postes de « chargé » (de mission, de projet, d’étude …) dans un océan de financements par projets** où la recherche d’une forme de cohérence est aussi vaine que la recherche d’une lueur d’intelligence dans le regard de Jean-Marc Morandini. A tous les étages, dans toutes les instances, sur chaque projet donc, local, national, européen, de pôle, de composante, de laboratoire, de site, à chaque fois que l’on identifie un projet dans lequel il faut « administrer », on recrute donc et on missionne pour administrer (parce que qu’on a les sous du financement par projet pour le faire et que de toute façon le dépôt de projet commence par poser le nombre de postes de « chargés d’un truc » qui seront nécessaire pour faire vivre le projet …). On recrute pour quelques mois, rarement pour plus d’un an. Mais on recrute. Le système finit par être totalement saturé par cette masse d’agents de « chargés d’un truc » qui (pour avoir échangé avec pas mal d’entre elles et eux) sont les premiers à confesser ne plus vraiment savoir ce qui dans leur poste de chargé de mission relève de la mission ou de la simple charge. Des gens qui vous avouent tout aussi souvent qu’ils ne parviennent pas à faire collectif, puisqu’ils n’opèrent que très temporairement et très à la périphérie de collectifs déjà eux-même constitués et passablement secoués et segmentés. Mais après tout … pourquoi pas. Pourquoi pas puisque pendant ce temps là ces gens fournissent un travail qui n’est fort heureusement pas totalement vain, qui est même parfois tout à fait utile, et qu’ils ont un salaire.
Mais primo, ces gens-là dont beaucoup s’impliquent bien au-delà de ce que leur fiche de paie ne le réclame, l’université n’est la plupart du temps absolument pas en mesure de les garder et de leur offrir une quelconque forme d’avenir, alors même qu’y compris sur les temps parfois très court qu’ils et elles y ont passé, beaucoup mériteraient cet avenir.
Et, deuxio, pendant que le système sature à tous les étages de postes relevant d’une forme quelconque et superfétatoire de « missionnage », les deux principales artères de l’université publique se bouchent et embolisent comme jamais : la possibilité de recruter des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS en nombre suffisant et sur des contrats pérennes est devenue notre premier renoncement et reste malheureusement – et je le crains pour encore longtemps – la source de nos dernières colères.
[**Concernant les appels et financements par projet je ne résiste pas à vous partager cette pépite dénichée sur le compte X de Samuel Hayat :
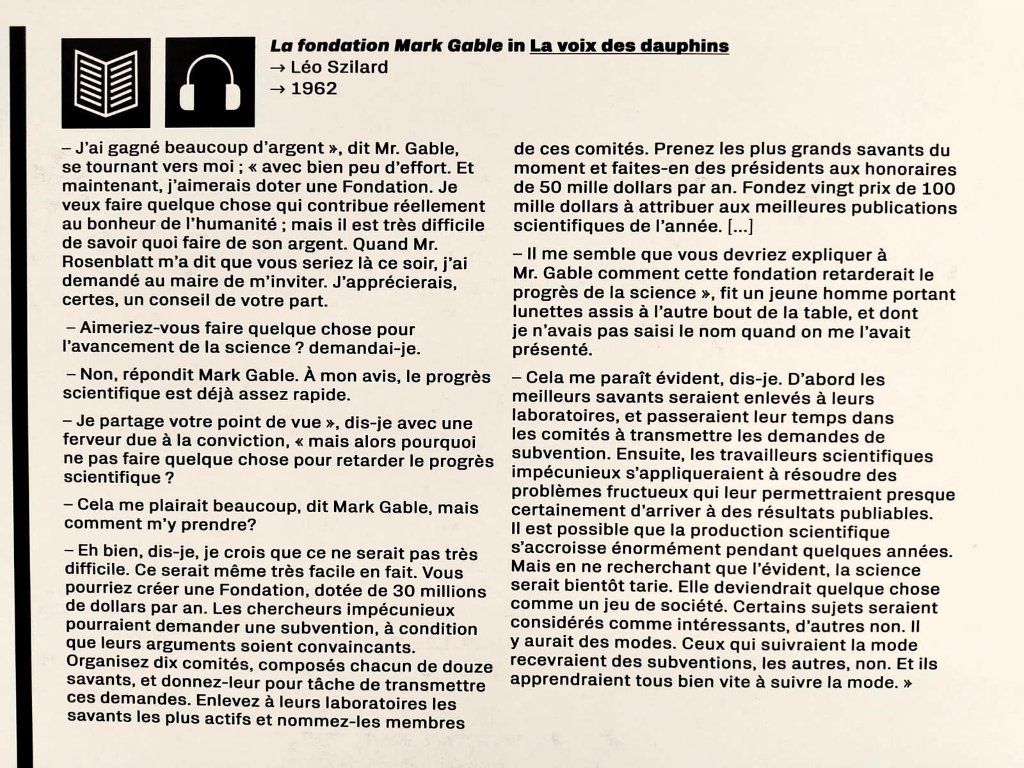
Les réunions d’occupation et celles d’encombrement.
Elles sont à la fois le premier coeur et la première plaie du fonctionnement universitaire. D’elles on sait déjà qu’il ne sortira aucune décision claire. Soit parce que les décisions sont déjà prises, soit parce que le dispositif, ou les gens en présence, ou l’ensemble de ces deux paramètres rend toute prise de décision impossible. Dans ces réunions d’occupation ou d’encombrement, chacun y entrera avec la claire conscience d’un temps possiblement perdu ; chacun y fournira le minimum de présence attendue dans le hochement de tête ou la question de courtoisie, de bon aloi et d’intérêt feint pour tenir le simulacre du théâtre de nos sociabilités ; chacun la quittera avec la confirmation du postulat de départ (celui d’un temps essentiellement perdu). Pourquoi les gens y viennent-ils alors ? Pour deux raisons aussi simples que précises : soit par le biais d’une fausse obligation fonctionnelle (« vous y êtes invité » ou mieux « vous devez y être« ), soit pour y faire ou y négocier tout autre chose que l’ordre du jour affiché, ou pour le faire dans ces temps qui précèdent ou qui suivent immédiatement les réunions mornes.
Des réunions de ce type j’en ai au moins en moyenne une par semaine à mon agenda et je ne suis que DAFS d’une petite composante (par la taille) dans une grande université (toujours par la taille). Mais à chaque fois que je suis sorti de l’une de ces réunions j’ai imaginé, essayé en tout cas, la vie de celles et ceux dont la quasi-entièreté des semaines est faite de ce genre de réunions d’occupation et d’encombrement, et qui auraient depuis longtemps toutes et tous démissionné sans leur capacité à s’auto-convaincre de l’utilité de ces « cercles » qui disent d’ailleurs déjà tout de leur inefficace récursivité là où il ne devrait y avoir que les linéarités. « Les gens qui pensent en rond ont les idées courbes. » chantait déjà le grand Léo. Seul point commun de l’ensemble de ces réunions : elles sont aussi intellectuellement stimulantes que l’EEG d’un chroniqueur de TPMP, et aussi vitales pour les urgences actuelles de l’université que peut l’être l’avis de Jean-Marie Bigard sur le féminisme intersectionnel. Le système ne tient que par l’accord tacite de chacun.e des participant.e.s à ces réunions de ne jamais le reconnaître devant l’ensemble des autres membres présents, mais de toujours le confesser auprès d’autres dont on se sent le plus proche. C’est réellement fascinant. Totalement mortifère et ubuesque mais totalement fascinant.
Notez qu’il est aussi, bien sûr, quelques réunions réellement décisionnelles à l’université mais j’observe que formellement elles s’organisent comme de fausses concertations arbitrées d’avance qui n’ont pour objet que de permettre l’expression semi-publique de mécontentements et la négociation d’autres objets ou sujets fonctionnant comme autant de points de fuite pour les rares cas ou l’expression des mécontentements deviendrait trop bruyante ou potentiellement majoritaire.
Et là bien sûr j’ai des dizaines d’exemples à vous donner. Et là bien sûr … je ne vais pas vous les donner 🙂 Non pas au nom d’un quelconque devoir de réserve, mais par respect pour plein de gens qui sont avant tout des collègues et des êtres humains participant du même cirque que moi mais avec des regards, des enjeux, des contraintes, des situations professionnelles, et des perspectives différentes. A deux reprises dans certaines de ces réunions, je me suis autorisé à explicitement verbaliser le fait que je n’en comprenais ni la logique ni l’intérêt et que je voyais mal comment ce constat de désintérêt total pouvait ne pas être partagé par l’ensemble des gens présents. J’ai recueilli au pire un silence poli (et la réunion continua) et au mieux quelques réactions expliquant que « oui certes bon mais quand même hein puisqu’on est là bon ben voilà quoi. » Bah oui quoi. Puisqu’on est là.
Mon gimmick.
Pour ne pas sombrer ou tout envoyer balader à la première contrariété, à la première blessure narcissique, au premier désaccord, et pour tenter de faire face à tous types et sortes de situations parfois extrêmement tendues ou conflictuelles, j’ai développé une sorte de réflexe, de gimmick qui est le suivant : »OK et après ? » (variante : « OK, parce que sinon il va se passer quoi ?« )
Pour l’essentiel des situations que l’on présente comme urgentes et qui sont génératrices de stress pour les équipes et les collègues, je m’efforce toujours de (me) poser ces simples questions et autant que possible les formuler également avec elles et eux : « Ok et après ? », « OK, parce que sinon il va se passer quoi ?« .
Exemple : on doit faire remonter et agréger des données impérativement pour dans 5 jours auprès de [truc moisi]. Mais de fait on sait qu’on ne pourra pas parce qu’on n’aura ni le temps ni les gens pour le faire ou alors cela implique que des gens vont rester là jusqu’à des heures indues et dans des situations de stress inutiles, ou que d’autres gens qui n’avaient pas vocation à faire ce boulot vont devoir le faire alors qu’ils et elles croulent déjà sous le boulot.
Donc on décide que … bah on ne va pas le faire. En tout cas ni dans les délais ni dans la forme où on nous l’a demandé. Et là … première tentative d’entrée par effraction dans les tréfonds de nos culpabilités qui prend quasi inévitablement la forme suivante « ah ben oui mais on n’a pas le choix« . Ah bon ? Et là on y va. Gimmick.
« OK, parce que sinon il va se passer quoi ? » En général la première itération donne un truc dans le genre :
- « Bah sinon [machin truc] va nous engueuler »
- « Bah sinon on ne pourra pas obtenir [machin truc] »
- « Bah sinon après ce sera trop tard »
- « Bah sinon on sera les seuls à ne pas l’avoir fait »
Et là, deuxième itération : « OK et après ? »
Et la plupart du temps la magie opère. Ce qui était inévitable devient évitable, ce qui était urgent ne l’est plus ou beaucoup moins, du coup ce qui était infaisable redevient possible, ce qui était craint devient dérisoire. Bien sûr ça ne marche pas à tous les coups et pour tous les sujets (et c’est là qu’interviennent les agents d’équilibre dont je parlais plus haut) mais au regard du régime d’urgence permanent de la vie administrative universitaire, ce processus dilatoire est un oxygène fondamental et nécessaire. En tout cas il l’a été pour moi et je l’espère pour quelques-un.e.s des collègues avec qui on a dû affronter ce genre de montagne russe émotionnelle et organisationnelle.
Et observer que 9 fois sur 10 (Institut Pifométrics Expérience) il n’y a pas « d’après ». C’est à dire que 9 fois sur 10 si l’on ne fait pas ce que l’on nous présente comme une injonction de faire, dans des délais infaisables, en mobilisant des énergies introuvables, après il ne se passe … rien. Absolument rien. Le ciel comptable de nous tombe pas sur la tête, le Poltergeist de la matrice excel ne vient pas dévorer nos enfants, la GMA (Grande Méchante Administration) n’envoie pas des tueurs à gage faire le ménage dans les services défaillants, les délais non-négociables deviennent négociés, les gens se détendent et on note à plusieurs reprises de doubles effets kiss cool puisque derrière elles et eux c’est toute une autre chaîne de gens qui se trouvaient également liés par cet infaisable qui se détendent également et finissent même parfois par nous en remercier. Là où cela devient parfois carrément jouissif, c’est que certains services eux-mêmes à l’origine de la demande impossible sont ravis d’acter le fait que nous n’y répondrons donc pas (et manifestent en loucedé leur soulagement et leur espoir que tout le monde en fasse de même).
Par la force d’habitudes devenus systémiques, nous avons fait l’erreur de considérer comme vrai le fait que l’ensemble des process imposés n’offriraient aucun espace possible de libération ou de délibération. Nous ne les vivons donc que comme des formes subies et sans cesse renouvelées d’alinéation. Et nous avons collectivement perdu de vue que nous sommes les seuls décisionnaires de ce qui peut et doit être fait et dans quelle temporalité, et que tout un ensemble de contraintes organisationnelles totalement exogènes à la vie de la composante mais présentées comme lui étant faussement consubstantielles doivent être démontées avec rage, combattues avec force, démantelées avec précision.
Nous devons nous souvenir qu’en dehors de très peu de choix qui impactent directement et immédiatement la vie de nos étudiantes et de nos étudiants ou de nos collègues, toutes les autres urgences ne sont liées que par un régime d’arbitraire qui leur permet de se présenter comme nécessaires. Derrière chacun de nos choix face à ces intenables qui sont le quotidien de tant de collègues et de services à l’université, il n’y a pas de précipice béant s’avançant pour nous avaler mais simplement un petit cliquetis très temporairement dysfonctionnel qui n’obèrera en rien de nos premiers essentiels, c’est à dire faire en sorte que tout se passe bien et surtout, tranquillement. Mais la crainte que toute erreur marginale ne devienne un irrémédiable arbitrage mettant en cause non seulement le processus et les services qui y ont conduit mais également l’image professionnelle des collègues qui en sont à l’origine, est l’outil à la fois le plus puissant et le plus pervers qu’il m’ait été donné d’observer.
Mais … mais pourquoi ?
Celles qui me connaissent ou me lisent depuis longtemps se demandent probablement ce que je fais ou tente encore de faire dans ces fonctions et responsabilités et pourquoi j’y reste et semble donc finalement m’y complaire un peu (alors que j’étais plutôt connu et reconnu comme le gars qui gueule très fort et claque très rapidement sa dém). Je vous avoue me poser moi-même souvent la question. Et fournis ces éléments de réponse. D’abord j’y gagne de l’argent à la fin mais je ne le fais pas pour l’argent, comme l’expliquent d’ailleurs doctement tous les gens qui font des trucs pour de l’argent ;-). En toute transparence je touche pour cette fonction de DAFS l’équivalent de 50 heures de cours (TD) par an.
Ceci étant posé, le premier vrai élément de réponse est que les engagements, quels qu’ils soient, sont toujours conjoncturels. Si je me suis engagé, comme responsable de département, comme DAFS, ou sur d’autres missions et fonctions auparavant, c’est d’abord parce qu’à chaque fois que je l’ai fait j’étais (et suis encore) dans un collectif qui non seulement me paraît mériter cet engagement et qui surtout m’y accompagne et me le rend possible (et quotidiennement supportable et fécond).
Si je le fais maintenant, ou plus exactement si je ne le fais que maintenant, c’est aussi parce que pendant des années j’ai eu la chance d’avoir ce même collectif de collègues qui ont accepté mon choix de ne pas le faire pour me permettre de faire essentiellement de l’enseignement et de la recherche et de m’occuper de mes enfants tant qu’ils étaient encore de petite choses fragiles nécessitant une attention constante de leur papounet (donc jusqu’à l’âge de leur majorité et de leur entrée à l’université, en tout cas dans mon référentiel personnel de l’autonomie des enfants ;-). Les collectifs se construisent dans le temps, et les collectifs les plus féconds sont aussi ceux qui sont capables de patience pour l’ensemble de leurs membres.
Là où j’ai changé, c’est que je croyais il y a quelques années encore que l’on ne pouvait pas changer le système de l’intérieur, qu’il fallait lutter et en dénoncer les travers, ne pas faire de concessions, et s’indigner publiquement à chaque fois que nécessaire avec toute la force dont on était capable, et puis démissionner à la fin. Et bien figurez-vous que … je ne crois toujours pas que l’on puisse changer le système de l’intérieur, sauf pour les quelques rares personnalités qui sont ces agents d’équilibre dont je parlais plus haut et qui font en sorte de le rendre supportable et d’en atténuer la violence systémique. Mais je crois qu’on a besoin de témoignages et de documentations de ces intérieurs de nos vies universitaires avec le peu de lucidité et surtout le luxe et la liberté infinie qu’offre le positionnement qui est le mien et que je me suis choisi dès mon premier poste à l’université, c’est à dire de renoncer par avance à toute forme d’avancement autre que celui de l’ancienneté afin de n’être entravé par absolument aucune logique de reconnaissance, de compensation ou d’alliance opportune nécessitant l’oubli même ponctuel de ses principes ou obligeant à des formes de retour d’ascenseur qui n’aient pas exclusivement l’amitié ou l’estime professionnelle comme moteur.
Chaque trajectoire est particulière et la mienne n’y fait pas exception, et l’origine de ce positionnement doit beaucoup à ce que j’ai à la fois vécu et observé (mais aussi subi) lorsque j’étais doctorant et post-doctorant et aspirais à obtenir mon premier poste (et que je vous raconterai peut-être un jour ;-). Mais plus de vingt ans après ma première titularisation sur un poste de Maître de Conférences à l’université publique, je n’ai jamais regretté d’avoir opté pour ce positionnement. Jamais.
Comme lorsque je concluais le tableau (un peu sombre) de ma première année de responsable de département, ne vous méprenez pas à la lecture de cet article. Mon expérience de DAFS est riche et je la traverse avec le bonheur curieux d’un anthropologue sur ses propres traces. J’y cherche ces mêmes affordances, ces affleurements qui nous rendent le monde palpable, qui éclairent son fonctionnement et qui organisent et déterminent nos sociabilités.
S’il fallait que je n’en retire ou n’en retienne qu’une seule certitude elle serait indubitablement la suivante : l’université publique est remplie de gens formidables et qui le seraient encore davantage s’ils n’étaient pas formidablement entravés par les nécro-politiques de leurs ministères qui sont la cause de toute chose, ainsi que par leurs propres assignations à résilience qui en sont les effets les plus visibles et les plus délétères.
Passez toutes et tous un bel été.
Et rendez-vous à la fin d’année prochaine pour une nouvelle chronique universitaire où je vous parlerai cette fois de ma première année en tant que président de Nantes Université 😉

Bonsoir
merci pour cette analyse fine, pertinente et précise de la situation de nos universités.
merci pour cette absence de langue de bois (celle qui tue à petit feu les agents d’équilibre dans les réunions d’occupation et d’encombrement).
merci de continuer quand même (moi, la retraite m’a extrait à temps de ce maelstrom). Mais je continue à me désespérer de voir mon université ( Rennes 1) plonger dans le déficit, de constater la décrépitude de la notion de service public.
ça ne console de rien, mais cela éclaire ceux qui ne savent pas sur la manière dont on est en train de mettre à terre nos universités.
Un agent d’équilibre