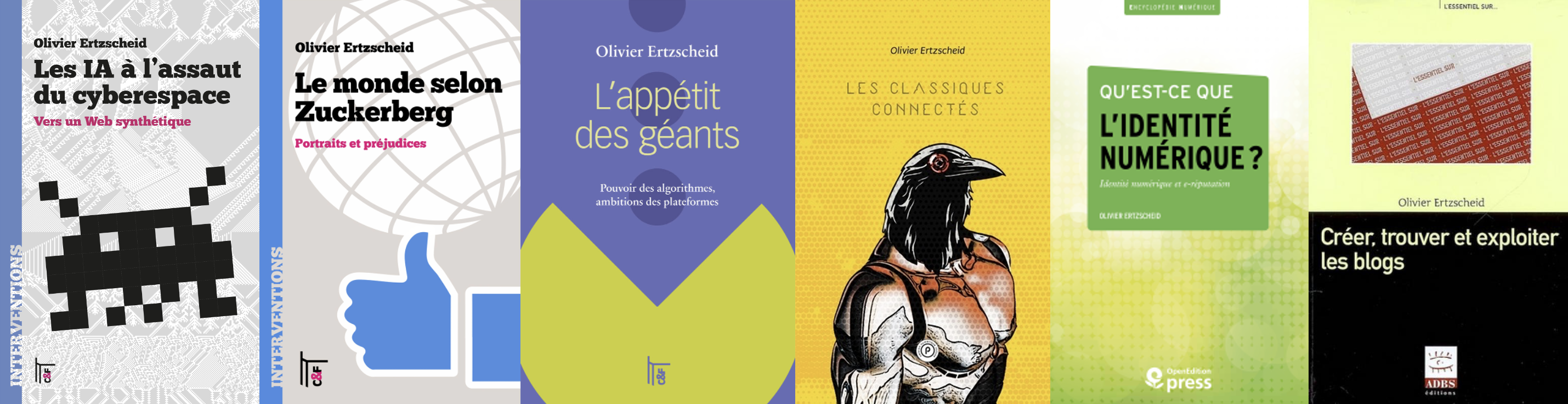Comme je le fais depuis quelques temps, certains de mes textes sont initialement publiés dans la revue AOC avant d’être republiés ici en version gratuite après embargo de 2 mois (sachant qu’AOC vous offre un article par mois gratuitement en échange de votre adresse mail).
Mon dernier texte s’intitule « Le réel, le vrai et la technorrhée. Comment la question du langage s’est déplacée. » Il est disponible sur AOC depuis le 20 octobre 2025 (et sera donc republié ici fin décembre). C’est un texte assez long et assez dense qui propose plusieurs concepts (celui de technorrhée, celui « d’assemblages machiniques informationnels », et quelques autres encore), travaille plusieurs aspects de l’IA au travers des différents générateurs (de texte, d’image, de vidéo), qui revient aussi sur les cadres discursifs et langagiers qui se trouvent bousculées et remodelés et tente de replacer ces dernières évolutions dans le temps long des espaces discursifs en ligne, qui ont, depuis l’invention des plateformes de médias sociaux, toujours été davantage astreignants que libératoires. Parmi quelques-uns des aspects développés dans ce texte, je vous livre ici deux courts extraits qui, je l’espère, vous donneront envie de lire l’ensemble sur AOC (et de vous y abonner, c’est un espace de réflexion et de respiration aussi salutaire que nécessaire dans l’époque actuelle).
Extrait 1.
« Il y a deux niveaux différents sur lesquels penser la complexification de nos anciennes heuristiques de preuve. D’abord la documentation récréative, ludique ou fictionnée du monde : l’enjeu est alors celui de la dissimulation ; il faut soit faire en sorte que le destinataire ne voit pas la simulation, soit qu’elle se dise pour ce qu’elle est (un « dit » de simulation) et qu’elle suscite l’étonnement sur sa nature. Et puis il y a la documentation rétrospective de tout ce qui fait histoire dans le temps long ainsi que celle qui concerne l’actualité. C’est alors l’exemple de la vidéo du SIG que j’évoquais plus haut, où le moindre casque à pointe nous fait basculer de l’ahurissement à l’abrutissement.
On croit souvent – et l’on s’abrite derrière cette croyance – que chaque simulation, chaque nouvelle production documentaire générée par intelligence artificielle, ajoute au réel. C’est totalement faux. Chaque nouvelle simulation enlève au réel. Parce que le réel historique n’est pas un réel extensible : il peut se nourrir de représentations historiques mouvantes au gré de l’historiographie et de l’émergence de preuves ou de témoignages, mais chaque nouvelle génération de ce réel historique potentiel va venir se sédimenter dans l’espace public mémoriel dont la part transmissible est extrêmement ténue et s’accommode mal d’effets de concurrences génératives. La question, dès lors, n’est pas tant de condamner les utilisations imbéciles ou négligentes de technologies d’IA pour illustrer un fait historique mais, par exemple, de savoir comment mieux rendre visible et faire pédagogie de la force incroyable d’authentiques images d’archives.
Nos imaginaires sont des réels en plus. Les effets de réel produits par les artefacts génératifs sont des imaginaires en moins.
(…) Il est en train de nous arriver exactement la même chose avec l’ensemble de l’actuelle panoplie des artefacts génératifs disponibles, de Genie 3 à ChatGPT5 : nous ne multiplions pas nos capacités collectives à faire récit (que ces récits soient imaginaires, réels ou réalistes et que leur support premier soit celui du texte, de l’image ou de la vidéo), nous les standardisons et nous nous enfonçons dans des dynamiques de reproduction qui se nourrissent de toutes les formes possibles de confusion ; une confusion entretenue par des formes complexes d’indiscernabilité qui tiennent à l’immensité non auditable des corpus sur lesquels ces IA et autres artefacts génératifs sont « entraînés » et ensuite calibrés.
Extrait 2.
À propos de ce que je nomme « Assemblages machiniques informationnels »
L’arrivée des artefacts génératifs ajoute une dimension nouvelle et passablement problématique au tableau contemporain de la fabrication de nos croyances et adhésions. Jusqu’ici, moteurs de recherche et réseaux sociaux jouaient sur le levier déjà immensément puissant de leurs arbitraires d’indexation et de publication (le fait de choisir ce qu’ils allaient indexer et/ou publier) ainsi que sur celui, tout aussi puissant, de la hiérarchisation et de la circulation (viralisation) de ce qui pouvait être vu et donc en creux de ce qu’ils estimaient devoir l’être moins ou pas du tout.
Choisir quoi mettre à la « Une » et définir l’agenda médiatique selon le vieux précepte de « l’agenda setting » qui dit que les médias ne nous disent pas ce qu’il faut penser mais ce à quoi il faut penser. Ce principe premier de l’éditorialisation se double, avec les artefacts génératifs conversationnels à vocation de recherche, d’une capacité à produire des sortes d’assemblages machiniques informationnels, c’est à dire des contenus uniquement déterminés par ce que nous interprétons comme un « devenir machine** » en capacité de « phraser » les immenses bases de données textuelles sur lesquelles il repose. Des machines à communiquer mais en aucun cas, comme le souligne aussi Arthur Perret, en aucun cas des machines à informer.
** [ce « devenir-machine » est à lire dans le sens du « devenir-animal » chez Deleuze et Guattari : « le “devenir-animal” ne consiste pas à “imiter l’animal, mais d’entrer dans des rapports de composition, d’affect et d’intensité sensible” ».]
Ce concept d’assemblage machinique informationnel me semble intéressant à penser en miroir ou en leurre des agencements collectifs d’énonciation théorisés par Félix Guattari. D’abord parce qu’un assemblage n’est pas un agencement. Il n’en a justement pas l’agentivité. Il n’est mû par aucune intentionnalité, par aucun désir combinatoire, calculatoire, informationnel, communicationnel ou social. Ensuite parce que la dimension machinique est antithétique de la dimension collective, elle en est la matière noire : ChatGPT (et les autres artefacts génératifs) n’est rien sans la base de connaissance sur laquelle il repose et les immenses réservoirs de textes, d’images et de contenus divers qui ont été, pour le coup, assemblés, et sont l’oeuvre de singularités fondues dans un collectif qui n’a jamais été mobilisé ou sollicité en tant que tel. Enfin, l’information est ici un degré zéro de l’énonciation. L’énonciation c’est précisément ce qui va donner un corps social à ce qui étymologiquement, a donc déjà été « mis en forme » (in-formare) et se trouve prêt à être transmis, à trouver résonance. ChatGPT est l’ombre, le simulacre, le leurre d’une énonciation. Et cette duperie est aussi sa plus grande victoire.
La question du langage s’est déplacée. Un grand déplacement. Quelque chose qui n’est plus aligné entre le territoire du monde et la langue qui en est la carte.