J’étais hier, Mercredi 21 Mai, à Nantes dans le cadre de l’événement « Pint Of Science » pour une soirée thématiques sur le thème « Algorithmes et société ».

Voici un retour sur mon intervention. Un très grand merci aux organisateurs et organisatrices (notamment Rémi) pour cette invitation et l’organisation de ce temps d’échange citoyen tout à fait réjouissant et fécond. Et un grand merci aussi à mes deux collègues d’intervention, Leia Savary et Odile Bellenguez pour les échanges et la préparation de cette soirée.
Voici donc ce que j’ai raconté de mon côté.
Je vais vous faire écouter un algorithme.
Je vais vous faire écouter un algorithme.
Ce titre de Sébastien Tellier sort en 2004. Il est intitulé « La ritournelle ». 2004 c’est aussi la naissance de Facebook et de ce que l’on va nommer les « réseaux sociaux » puis les « médias sociaux » de masse. C’est aussi à partir de ce moment là que bien plus que pendant les précédentes années, le web, espace public ouvert et traversable, va se « refermer » autour de plateformes propriétaires (le fondateur du web, Tim Berners-Lee, parle de « jardins fermés ») et que les « applications » vont devenir nos compagnons quotidiens avec la massification des smartphones (circa 2007).
Dès lors, à partir de ces années et dans la décennie qui s’ouvre en 2010, « les algorithmes » vont devenir autant de ritournelles qui nous accompagnent, nous cadrent, nous autorisent et nous empêchent au quotidien. Pourquoi ce titre de Sébastien Tellier et pourquoi comparer les algorithmes à des ritournelles ? Parce que le titre « la ritournelle » fait écho à ce qui me semble la meilleure définition de la nature profonde d’un algorithme et surtout de la nature profonde des effets d’un algorithme. Et cette définition je la tire de l’ouvrage de Deleuze et Guattari, « Mille Plateaux », paru en 1980 et qui avait pour sous-titre « Capitalisme et Schizophrénie » (ce qui est aussi intéressant pour penser le rôle actuel des algorithmes dont beaucoup enferment et « rendent fou » parce qu’ils ne sont au service que du Capital).
Donc dans Mille Plateaux, Deleuze et Guattari parlent de l’importance de ce qu’ils appellent la ritournelle et qu’ils décrivent en trois points :
- D’abord ce qui nous rassure par une forme de régularité attendue, que l’on devine et anticipe.
Les algorithmes sont cela.
- Ensuite ce qui installe l’organisation nous semblant familière d’un espace que l’on sait public mais que l’on perçoit et que l’on investit en partie comme intime : ils « enchantent » l’éventail de nos affects et sont l’état de nature de nos artifices sociaux.
Les algorithmes se déploient dans ces espaces à la fois massivement publics en nombre d’utilisateurs mais qui sont aussi, en faux-semblant, « privés ». Cela avait été posé dès 2007 par danah boyd qui soulignait que la première particularité et le premier problème de ces plateformes était qu’elles étaient semi-publiques et semi-privées et que toute dimension de « privacy », c’est à dire de vie privée, était donc structurellement ambigüe et presqu’impossible.
Deleuze et Guattari disent aussi que la ritournelle (donc les algorithmes) « enchantent nos affects » et sont « l’état de nature de nos artifices sociaux ». « L’état de nature de nos artifices sociaux. » C’est, je trouve, vraiment une magnifique définition de ce qui se joue, de ce que nous jouons autour de notre fréquentation algorithmique. La visibilité, la réciprocité, le souci de paraître, les fonctions comme le like et les autres icônes « émotionnelles » sont, parmi d’autres, les notes de la partition de cette ritournelle.
- Enfin ils sont ce qui, parfois, nous accompagne et nous équipe aussi dans la découverte d’un ailleurs, parce qu’y compris au sein de représentations cloisonnées, ils sont des « chants traversants. »
Là encore, c’est dans le mille. Des « chants traversants » : les algorithmes, notamment ceux que l’on dit de recommandation, fonctionnent comme des chants traversants : la plupart du temps ils s’alignent sur nos préférences mais ils sont aussi structurellement faits pour nous emmener vers des ailleurs afin de maintenir un niveau d’attention qui ne s’effondre pas dans une trop forte routine.
Ces ritournelles nous accompagnent et elles « cadrent » notre réel. Notre réel amoureux, notre réel géographique, notre réel politique. Elles le cadrent et elles le rythment.
Je vais maintenant vous parler du rythme des algorithmes.
Dans un vieux texte j’avais imaginé un trouble que j’avais appelé la « dysalgorithmie », un « trouble de résistance algorithmique où le sujet fait preuve d’un comportement ou d’opinions non-calculables« , c’est à dire la capacité à ne pas suivre les recommandations algorithmiques, à n’être, par exemple, pas sensible à la cadence des notifications. C’est à dire à être dans un autre rythme de la même manière que les différents troubles « dys » sont différemment sensibles au monde, à l’orthographe, au calcul.
Ma thèse c’est que chaque algorithme dispose de son propre rythme. Le rythme de l’algorithme de Tiktok n’est pas le même que celui de l’algorithme de X ou d’Instagram. Si l’algorithme de Tiktok nous parait si efficace, ce n’est pas parce qu’il serait plus intelligent ou machiavélique que d’autres, c’est parce que son rythme (séquences très courtes) impose que nous nous en occupions en permanence, à un rythme constant, et chaque interaction, chaque pulsation, est une nouvelle information pour cet algorithme. Or en moyenne toutes les 6 à 10 secondes nous interagissons avec l’algorithme de TikTok.
Et mon autre thèse qui est un corrélat de la première, c’est que ces algorithmes jouent aussi sur la question de nos propres rythmes ils cadencent comme autant de contremaîtres nos vitesses de déplacement – Waze – mais aussi nos vitesses de connexion, d’information , de socialisation, nos fréquences de rencontre amoureuses, etc.
Le problème c’est qu’à la fin c’est trop souvent le rythme de l’algorithme qui gagne. Qui l’emporte non seulement sur notre propre biorythme, mais sur le rythme de nos sociétés, de nos environnements sociaux, amicaux, informationnels, affectifs mais aussi sur d’autres aspects parfois plus triviaux. Je prends quelques exemples.
L’algorithme de Facebook, derrière la promesse de nous exposer à davantage de diversité, nous a en réalité enfermé dans nos certitudes, dans nos propres croyances, dans ce qu’Eli Pariser a appelé des « bulles de filtre ». Ce n’est d’ailleurs pas « que » la faute de Facebook. Il y a une nature anthropologique à ces bulles de filtre : plus on nous sommes seuls à être exposé à des diversités de culture, de religion, de sociétés, et plus nous cherchons à nous rapprocher de ce qui nous est semblable ; plus nous cherchons à nous rapprocher de notre propre rythme. En ce sens la promesse inititale de Facebook a été tenue : la plateforme nous a en effet exposé à énormément de diversité, mais de manière tellement outrancière que nous avons fini par n’y chercher que de l’identique, du même, du ressemblant. Et dès lors que nous l’avons trouvé, nous nous y sommes enfermé avec l’aide des logiques publicitaires et virales totalement perverses qui alimentent la plateforme.
L’algorithme d’AirBnB a fini par reconfigurer totalement l’espace social de nos centre-villes. En affirmant rendre plus abordable le séjour, il a en réalité totalement raréfié l’offre de logements abordables dans certains périmètres urbains.
L’autre exemple c’est celui de Waze. L’histoire est désormais un peu plus célèbre car elle figure à la fin du dernier livre de Guiliano Da Empoli, « L’ère des prédateurs », mais elle est ancienne. C’est celle d’un maire, Christophe Mathon, d’un petit village, Saint-Montan, une cité médiévale de 180 habitants nichée dans les confins de l’Ardèche. Et à chaque vacance scolaire ou long week-end un flot de véhicules (plus de 1000 par jour), le tout pour gagner quelques minutes ou secondes sur un itinéraire. Autre exemple, Matthieu Lestoquoy, maire de Camphin-en-Carembaut, commune de 1800 habitants, plus de 14 000 passages de véhicule par jour. Avec les dangers et les nuisance sonores que cela représente. Là encore au prétexte de fluidifer le trafic routier et de nous faire gagner du temps, Waze densifie le trafic routier dans des endroits non-prévus pour cela (et c’est donc beaucoup plus dangereux) et ne nous fait pas réellement gagner de temps et surtout il en fait perdre à l’ensemble des habitants de Saint-Montan ou de Camphin-en-Carembaut, dont il se contrefiche.
Au final, ces algorithmes nous promettent des choses (voir plus de diversité, avoir des logements plus accessibles, gagner du temps) mais en réalité, soit ils font l’inverse, soit ils créent tellement d’externalités négatives que la pertinence de leur fonction première peut et doit être rediscutée.
« Management, travail, données, infrastructures de production, modèle économique, stigmatisation des minorités et des plus pauvres … Il faut non seulement constater mais accepter que le monde social que les technologies numériques et algorithmiques bâtissent depuis presqu’un quart de siècle est un monde dans lequel se révèlent et s’organisent les puissances les plus radicales et aliénantes de l’histoire économique, sociale et politique des peuples. Cela n’empêche pas que les appropriations singulières de ces technologies numériques soient toujours possiblement vectrices d’émancipation mais en revanche, leurs appropriations collectives et politiques le sont très rarement. Presque jamais en réalité. Et chaque fois qu’elles l’ont été, l’émancipation s’est toujours retournée en répression.«
Pour le dire plus simplement : ces algorithmes facilitent énormément de choses à l’échelle individuelle (échelle où le rapport bénéfice / risque reste positif) mais ce rapport s’inverse très souvent à l’échelle collective. Or le seul bon niveau d’analyse de ces algorithmes, ce n’est pas tant l’effet qu’ils produisent sur nous, mais c’est celui des effets qu’ils produisent dans la société : les nouveaux cadres, les nouvelles normes qu’ils installent et légitiment.
On peut dans le même genre penser au travaux de Zeinep Tufekci, sociologie, hacktiviste, militante, qui a documenté, notamment dans le cadre des printemps arabes, « comment internet a facilité l’organisation les révolutions sociales mais en a compromis la victoire. » Et quand elle dit « internet » elle désigne en fait les grands médias sociaux et leurs algorithmes.
Alors devant tout cela, on pourrait se dire que l’une des solutions, simple en apparence, c’est d’ouvrir le code de ces algorithmes, et de regarder attentivement comment est faite la partition de ces ritournelles, et nous pourrons nous en affranchir, que nous pourrons les améliorer et les ramener dans le sens de l’intérêt commun.
Malheureusement, aujourd’hui, ouvrir le code des algorithmes ne suffit plus (même si c’est plus que jamais nécessaire)
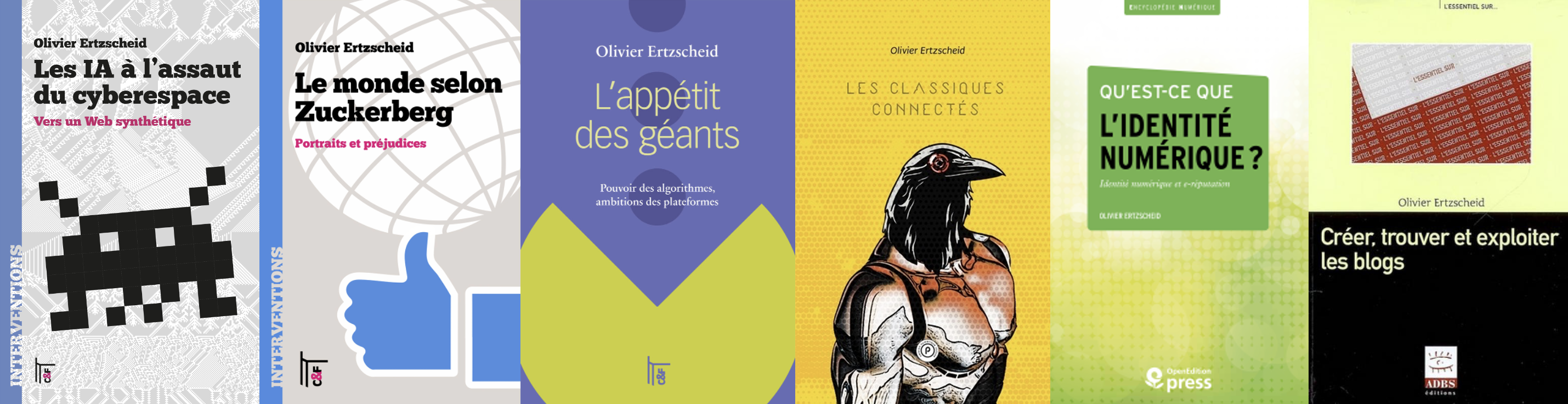

Bonjour,
Merci pour cet excellent article.
Je sens que cette approche des » ritournelles algorithmiques » va m’accompagner quelques temps.