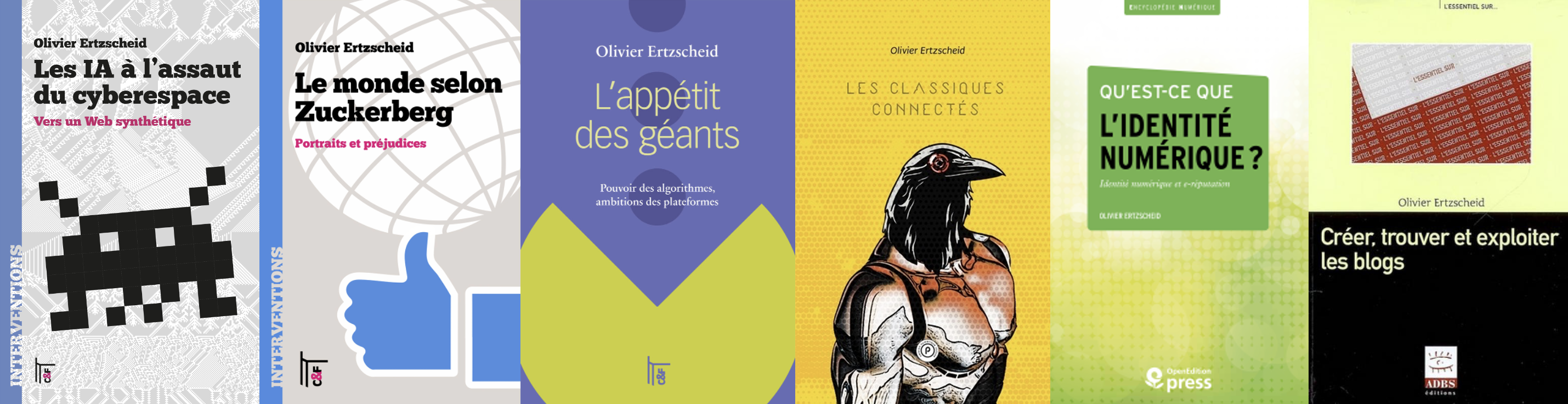Longtemps le numérique fut envisagé et traité comme ce qu’il était en première intention : un moyen de stockage. Et à ce titre la possible et pratique externalisation de nos mémoires, mémoires documentaires d’abord, mémoires intimes ensuite.
Je suis récemment tombé sur un article expliquant comment le recours à l’IA allait permettre de redonner vie à la série Caméra Café, notamment en clonant – avec leur accord – les deux acteurs principaux et en les rajeunissant, mais aussi je cite : dans l’optique de « moderniser la série » et de « faire revivre [le] catalogue [de la maison de production]. »
On s’était habitué aux suites menant à Rocky 5 ou à Rambo 4 ou plus récemment à Fast And Furious 10, on vit également l’émergence des séries, reboots, préquels et autres déclinaisons « d’univers » ou de tonneaux des Danaïdes scénaristiques baptisés « multivers », mais aujourd’hui avec l’IA ce à quoi nous assistons c’est à l’industrialisation de ces multivers comme autant de répliques d’univers à moindre coût. Et ce pour permettre de doper de vacuité d’anciennes têtes de gondole d’audience en leur donnant une nouvelle et artificielle jeunesse, mais aussi et surtout une nouvelle surface et amplitude de diffusion.

Têtes de clones.
L’article de Marina Alcaraz dans Les Échos explique ainsi que l’IA sera utilisée dans 4 objectifs distincts :
« D’abord, pour reprendre tout le catalogue français du programme tourné au début des années 2000 (environ 700 épisodes) et le passer au format actuel en 16/9 et 4K. L’IA sert à reconstituer les images manquantes et à moderniser le rendu.
Ensuite, les nouvelles technologies sont utilisées pour indexer les épisodes et analyser les textes. Exit les termes de l’époque, comme Walkman, les références à l’actualité ou à la politique du début du millénaire. « Quand les dialogues parlent de choses que les jeunes ne connaissent pas, l’IA va les remplacer par des mots ou des expressions plus d’actualité », explique Jean-Yves Robin, président de Robin & Co.
Enfin, l’IA va créer des deepfakes des comédiens, dont ceux Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h, pour les insérer dans les versions issues de l’international. On estime qu’il y a 5.000 à 6.000 épisodes produits dans le monde, dont environ la moitié d’originaux, reprend le producteur. On pense pouvoir au moins doubler le catalogue français. C’est une façon de faire revivre les catalogues sur des fictions comme celle-ci, où des comédiens sont trop âgés. »
Cet exemple est particulièrement intéressant car il mobilise en effet les quatre ressorts actuels des enjeux de l’IA dans le contexte des industries culturelles. Un enjeu d’abord technique d’optimisation et de « modernisation » (pour autant que l’idée de modernisme ait un sens lorsque l’on parle d’IA). Un enjeu ensuite « éthique » qui mobilise la question de l’intégrité documentaire des oeuvres (et d’une forme de « cancel culture », j’y reviendrai). Un enjeu juridique qui touche à la fois au droit d’auteur, au droit à l’image et à la propriété intellectuelle ; ici les comédiens ont accepté d’être clonés contre rémunération et il serait d’ailleurs intéressant de voir quel type de contrôle ils ont accepté de céder sur leur image, et jusqu’à quand. Et enfin un enjeu économique de saturation et de maximisation des logiques d’exploitation par procédé de duplication dans un univers médiatique déjà passablement saturé et qui vient encore alourdir le poids de ce que l’on appelait « les étagères infinies », c’est à dire l’immensité de catalogues de contenus dans lesquels on passe davantage de temps à choisir quoi regarder plutôt qu’à simplement … regarder.
Désormais, il semble qu’aucun contenu culturel ayant eu ne serait-ce qu’une once de succès d’audience ou critique ne puisse et ne doive mourir ou être oublié. Tout doit être fait pour le maintenir artificiellement en circulation médiatique. C’est une sorte de palimpseste à l’envers, dans lequel on partirait de la version la plus aboutie de l’oeuvre originale pour ensuite la recouvrir de couches affadies de ses propres extensions, dérivations, réécritures et copies.
[Mise à jour du 23 Juillet]
Autour de ce sujet on pourra également se référer au concept de « Foreverism » de Grafton Tanner, ainsi qu’aux pages de Deleuze sur la question de la répétition.
[/Mise à jour]
Dans un tout autre registre, je m’étais il y a quelques années intéressé au fait que les profils Facebook de personnes décédées continuaient d’être une manne d’interaction (et donc de revenus) pour la plateforme ; plateforme qui avait ainsi tout intérêt à nous inciter à transformer ces comptes en autant de « mémorial » et à nous rappeler de souhaiter les anniversaires de nos amis morts. Il s’agissait et il s’agit toujours de se payer, encore et encore, jusqu’au bout du cynisme.
C’est un peu le même type de processus auquel nous assistons aujourd’hui avec ces maisons de production qui veulent encore se payer sur des contenus culturels (ici des séries) pourtant déjà au bout de toutes les logiques de rentabilité existantes : en l’occurence, pour la série Caméra Café, elle a déjà été vendue et exploitée dans plus de 60 pays, et tous les produits dérives possibles et imaginables ont également été exploités et surexploités.
Intégrité documentaire.
C’est pour moi le grand sujet des années qui s’ouvrent devant nous. Car avec l’IA, et comme cela est relaté dans l’article de Marina Alcaraz pour Les Échos, vient aussi la tentation d’effacer toute forme de référence à l’actualité de l’époque de production du contenu concerné. On parle ainsi de gommer le « walkman » pour le remplacer par autre chose qui parle à la nouvelle « cible » envisagée. Toujours d’après le prodicteur de la série, grâce à l’IA, exit aussi les références à l’actualité politique de l’époque. Ce qui vient nourrir encore le débat sur une forme de Cancel Culture. Ou comment réécrire des contenus culturels qui ne peuvent être autre chose que le reflet d’une époque avec tout ce que cette époque comportait de tolérance qui nous semble aujourd’hui relever légitimement de formes d’abus condamnables.
De mon côté, plutôt que de m’enferrer dans le débat souvent glissant de la « cancel culture » je préfère parler et questionner le thème de l’intégrité documentaire.
Je vous en ai souvent parlé sur ce blog, mais la première fois que j’ai commencé à réfléchir à la notion « d’intégrité documentaire » c’était lorsque j’écrivais beaucoup sur « l’affaire » Google Books et la manière dont le moteur s’était soudainement mis à numériser à très large échelle des livres du domaine public mais aussi des ouvrages sous droits, et où avaient émergé, pour l’ensemble des contenus culturels, les offres de streaming allant avec une forme manifeste de dépossession des anciens supports physiques (CD, DVD, etc.) qui nous privaient ce faisant de certains de nos droits de propriété (j’avais même appelé cela « l’acopie« ). Bref c’était il y a plus de 20 ans. Pour expliquer cette notion d’intégrité documentaire auprès de mes étudiants j’utilisais et j’utilise encore souvent l’exemple des éditions des grands classiques en version « digest » disponibles aux USA du type « la bible en 20 pages » ou « les misérables en 50 pages. » Je leur explique que si l’on n’est confronté qu’à la version « courte » des misérables, version dont on a expurgé non seulement différents niveaux de l’intrigue mais dont on a aussi modifié, pour les atténuer, les aspects paraissant les plus « choquants », le référent culturel que l’on construit et les comportements et les repères sociaux communs qu’il permet d’inscrire dans un horizon culturel partagé changent alors de manière radicale. En modifiant et en édulcorant « Les misérables » comme oeuvre littéraire (ou fait culturel) on influe nécessairement sur la perception que nous aurons de « la misère » comme réalité sociale. De la même manière et en prolongement, le fait de choisir, sur telle ou telle édition ou réédition, numérique ou non, d’enlever, de gommer ou de réécrire certains aspects de l’oeuvre sont une atteinte claire à son intégrité documentaire et constitue donc aussi un trouble à la diachronie et à la synchronie dans lesquelles toute oeuvre s’inscrit.
C’est d’ailleurs ce que l’historienne Laure Murat rappelle encore dans son dernier essai (que je n’ai pas encore lu) « Toutes les époques sont dégueulasses » mais dont j’ai pu entendre une interview sur France Inter dans laquelle elle expliquait ceci :
Faut-il corriger les textes pour qu’ils soient lisibles à nos yeux contemporains ? Laure Murat : « Je crois que la question pose un gros problème. Parce que si vous nettoyez les textes des sujets qui fâchent, des mots qui fâchent, vous aboutissez à une falsification et un mensonge historique, qui a pour conséquence très grave de priver les opprimés de l’histoire de leur oppression. Donc, supprimez les remarques misogynes de James Bond et ses actions – parce qu’il faut aussi toucher à l’intrigue – ça devient quand même nettement plus compliqué. Faites-en un proto-féministe, il y a beaucoup de travail, et vous ne comprendrez plus rien à la misogynie des années 1950-60. Et je crois que ce n’est pas une bonne idée. »
Alors on pourra certes arguer que la suppression d’un Walkman dans Caméra café n’a pas la portée symbolique de la réécriture d’une oppression, mais quid des blagues machistes ou sexistes de la série qui, à l’époque déjà, jouaient d’une ambiguïté sur la « beaufitude » de celui qui les énonçait ? Faut-il également les réécrire au risque, en effet, de ne plus rien comprendre au sexisme et à la misogynie du début des années 2000 ?
« Celui qui oublie ou qui méprise l’histoire est condamné à la revivre » écrivait le philosophe George Santayana. La seule promesse d’une Cancel Culture qui au prétexte de l’IA, finirait par faire système à l’échelle de nombre de biens et produits culturels, c’est le retour en plus violent de ce passé effacé.